La France est désormais le pays au plus fort taux d’incidence dans le monde concernant le cancer du sein, d’après le CIRC*. Comment expliquer cette regrettable pole position ? Si un tiers des cancers du sein sont le fait de causes évitables, et que 5 à 10% sont d’origine génétique, restent plus de 50% des cas à propos desquels nous avons encore trop peu de connaissances ou trop peu de marge de manœuvre. Est-ce plutôt l’eau que nous buvons, l’air que nous respirons, les aliments que nous ingérons qui expliquent l’augmentation, partout dans le monde, du nombre de cancers et ce sur-risque français ? D’où vient le danger et comment s’en prémunir ?
Les facteurs de risque connus
Les facteurs de risque de développer un cancer du sein sont nombreux et pour certains corrélés au mode de vie. Le CIRC estime par exemple qu’en 2015, 15% des cancers du sein étaient attribuables à la consommation d’alcool. Par ailleurs le surpoids et l’obésité, une alimentation déséquilibrée, la prise de contraceptions oestroprogestatives, de certains traitements hormonaux pour la ménopause, le travail de nuit, la sédentarité, sont des causes de mieux en mieux connues concernant le cancer du sein. En dehors de notre mode de vie, le facteur génétique représente quant à lui 5 à 10% des cancers du sein. D’où viennent donc les 55 à 60% cancers du sein restants ? Perturbateurs endocriniens cachés dans nos plastiques, mobiliers, cosmétiques, produits ménagers, etc. ? Pesticides et alimentation ultra-transformée et donc ultra-dégradée saturées de conservateurs et d’additifs ? Pollution atmosphérique ? Les causes sont multiples, les mécanismes de contamination complexes et d’après la Pr Francelyne Marano, biologiste et toxicologue environnementale et Présidente du comité de pilotage « Cancer et Environnement » à la Ligue contre le cancer, la synergie de toutes ces causes potentialisent leur impact sur la survenue des cancers. En ce qui concerne la pollution atmosphérique, l’étude XENAIR effectuée sur 8 polluants atmosphériques montre que 9% des cas de cancer du sein pourraient être évités si l’on se rapprochait des seuils d’exposition recommandés en 2021 par l’OMS pour le dioxyde d’azote (NO2), à savoir 10 µg/m3. Cette question de notre exposition à des toxiques devient d’ailleurs un sujet de combat pour de nombreuses femmes (et d’hommes car moins de 1% des cas de cancer du sein affectent des hommes) qui pourtant sont actives, ne boivent pas, ne fument pas, mangent équilibré et qui cependant découvrent, de plus en plus jeunes, qu’elles ont un cancer du sein. Ces femmes aujourd’hui montent au créneau, sous l’impulsion notamment de Fanny Arnaud, co-auteure d’une tribune parue le 19 octobre 2024 dans le journal Le Monde et signée par plus de 1000 femmes de moins de 40 ans touchées par un cancer du sein. Les autrices rappellent que : « Sont incriminés ou suspectés dans le développement et l’agressivité des cancers du sein, les pesticides, la pollution de l’air ou encore des composants du plastique. […] Or les substances chimiques issues de nos sociétés hyperindustrialisées se comptent en centaines de milliers, et seule une petite partie a fait l’objet d’une évaluation approfondie en matière de toxicité. ». Ces femmes qui font partie des 6% développant un cancer avant 40 ans se confrontent toutes à cette même question légitime « Pourquoi nous ? ». Pourquoi elles, qui ne présentent pas particulièrement de causes apparentes ? Que doivent-elles cesser de respirer, de boire ou de manger pour ne pas risquer une récidive ou voir davantage de leurs jeunes amies touchées à leur tour ?
Coïncidence géographique ?
Rebondissons à présent sur notre triste record du monde. Avec 105,4 cas de cancers du sein pour 100 000 habitants, la France vient de dépasser la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg, qui avaient jusqu’ici une plus forte incidence que nous. La France forme désormais avec ses tout proches voisins le quatuor de tête mondial sur l’incidence du cancer du sein. « On peut s’interroger sur la proximité géographique de ce malheureux peloton de tête. », lance André Cicolella, Président du Réseau Environnement Santé (RES) lors du colloque que l’association a organisé durant Octobre Rose 2024 sur les causes environnementales du cancer. Les similitudes et disparités d’incidence du cancer du sein, d’une région du monde à l’autre, sont déjà connues. A titre d’exemple, alors qu’en Europe, l’incidence du cancer du sein était de 75,6 sur 100 000 habitants en 2022, à la même période elle était de 34,3 en Asie et précisons que le Japon et la Corée, qui sont proches des pays d’Europe de l’Ouest en termes de niveau d’industrialisation sont également ceux qui ont la plus forte incidence en Asie. Même au sein des pays européens les disparités peuvent être assez marquées puisque l’incidence du cancer du sein est de 94 pour 100 000 habitants au Royaume-Uni, 87 en Italie, 81 en Espagne, 77 en Allemagne et 69,5 en Autriche (explorer ici la carte du CIRC). Le cancer du sein est-il une fatalité géographique ? La question est pertinente pour les Parisiens présentent un sur-risque de 15% sur le cancer du sein (source) ! Au sujet de cette particularité parisienne, on notera que la concentration de NO2 à Paris était en moyenne de 51 µg/m3 en 2022 (sources Airparif), donc encore loin des 10 µg/m3 recommandés par l’OMS, malgré des progrès effectués ces dernières années.
Comment agir ?
Le nombre de cancers du sein a doublé ces 30 dernières années et le CIRC estime qu’en 2050, l’incidence des cancers aura augmenté de 77 % dans le monde. Si l’on n’agit pas dès maintenant, en France, on pourrait atteindre 75 000 nouveaux cas de cancers du sein et plus de 20 000 décès par an (contre 61 214 nouveaux cas en 2023 et 12 146 décès en 2018 selon Santé publique France).
Les prises de conscience sont réelles et de plus en plus assorties d’actions concrètes. Ainsi, à Paris par exemple, la concentration de NO2 est passé de 73 µg/m3 en 2015 à 51 µg/m3 en 2022. Cependant dans le même temps, les connaissances s’affinent sur les niveaux de toxicité des polluants et des perturbateurs endocriniens et l’OMS a justement baissé les seuils de concentration de NO2 de 40 à 10 µg/m3 en 2021. Cela peut donner l’impression de nager à contre-courant mais tous les espoirs sont permis. « Il est vrai que l’on arrive désormais à un palier et que pour infléchir la tendance de nos expositions aux toxiques, il faut agir avec plus d’ambition. Cependant des villes comme Stockholm parviennent à atteindre des niveaux de pollution atmosphérique très corrects. Pourquoi pas nous ? », lance la Pr Francelyne Marano. S’il est indispensable que les pouvoirs publics prennent des décisions fortes pour nous protéger des toxiques de notre environnement extérieur comme intérieur, chacun peut aussi faire sa part. La Ligue contre le cancer espère d’ailleurs faire enfin bouger les lignes grâce à son projet « Ma Ville se ligue », orienté vers les élus dans le but de les sensibiliser à la prévention primaire dans le cadre du cancer.
« Nous formons les référents de la Ligue partout en France et éditons des brochures sur les causes environnementales du cancer, afin de faire passer les bons messages dans les collectivités, les écoles. Nous soutenons également le programme « Rues scolaires » qui consiste à interdire la circulation des voitures dans les rues où se trouvent des écoles maternelles et primaires, au moment de leur ouverture et fermeture. Bien sûr ce n’est pas du goût de tous les usagers de la route et ce n’est pas facile à mettre en place car il faut des agents pour réguler les déviations mais c’est possible puisque Paris l’a mis en œuvre. Cela évite les nombreuses voitures stationnées devant les écoles, moteur allumé, qui engendrent une importante pollution atmosphérique pour les riverains et surtout pour les enfants. Or on sait que plus les expositions aux toxiques ont lieu tôt dans la vie d’un individu, et plus le risque de développer un cancer à l’âge adulte augmente. Par ailleurs cela encourage à la marche à pied alors qu’il est prouvé que la pratique régulière d’une activité physique participe à la réduction des risques face au cancer. », ajoute l’experte en concluant par une invitation à aller jeter un œil sur une liste de gestes individuels du quotidien proposés par La Ligue pour aider à réduire l’exposition à la pollution environnementale et que nous reprenons ici :
- limiter les trajets en voiture thermique de moins de 5km ;
- pratiquer l’écoconduite ;
- favoriser la mobilité douce (marche, vélo, transport en commun, etc.) ;
- réduire ou éviter de faire du sport d’intensité élevé en extérieur lors de pics de pollution, particulièrement pour les personnes vulnérables ;
- améliorer le système de chauffage de son logement ;
- isoler son logement ;
- limiter l’utilisation de la climatisation ;
- entretenir sa cheminée ou poêle à bois ;
- consommer local et de saison.
*Centre International de Recherche sur le Cancer


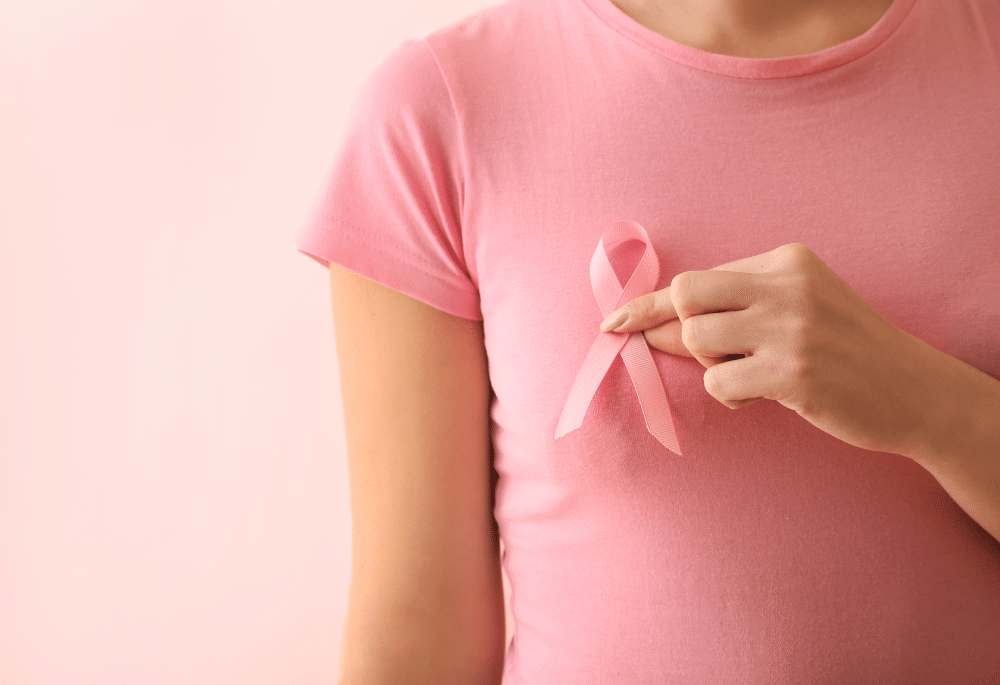

Laisser un commentaire public