Nous l’avons vu récemment dans 66 Millions d’Impatients, avec nos articles sur la médecine générale, la kinésithérapie, les soins dentaires à domicile, les opticiens et infirmiers mobiles, la médecine se déplace désormais de plus en plus à domicile. Il existe même la possibilité de transporter l’hôpital chez le patient. C’est ce que l’on appelle l »Hospitalisation à domicile »ou HAD.
De nombreux établissements, presque partout en France, proposent ce type d’hospitalisation qui regroupe alors des équipes de soins spécifiquement dédiées et doit assurer un niveau de qualité des soins et de sécurité aussi exigeant qu’en centre hospitalier.
L’hospitalisation à domicile (HAD), pour qui ?
Selon ce que propose l’établissement, l’hospitalisation à domicile peut concerner par exemple :
- la pédiatrie pour la prise en charge d’enfants,
- l’obstétrique pour les suites d’un accouchement,
- les patients en post-chirurgie,
- les soins palliatifs…
L’hospitalisation à domicile (HAD) peut aussi être envisagée sur des soins ponctuels, par exemple pour suivre un patient sous chimiothérapie. Il arrive même que certains patients qui désirent reprendre parallèlement le travail puissent en bénéficier.
Les conditions pour bénéficier d’une HAD ?
Outre le fait qu’il faille que la pathologie et l’état de santé du patient permettent au médecin d’autoriser une HAD, il faut également que l’environnement du malade soit adapté.
En effet, un logement inadapté (trop exigu, mal isolé du bruit, de la chaleur ou du froid, voire insalubre) peut être un frein à l’hospitalisation à domicile du malade, lequel aura tout intérêt pour des raisons de sécurité et de confort à rester à l’hôpital.
En outre, l’entourage du malade est très important. Un trop grand isolement social peut empêcher une HAD car entre chaque visite du personnel soignant, il faut prévoir que quelqu’un puisse quand même s’occuper du malade, surtout si celui-ci a des difficultés à se mouvoir par exemple.
Une HAD se décide donc avec l’accord du médecin, du malade mais aussi celui d’une assistante sociale et de l’entourage du patient (famille, amis, voisins…).
Une fois cet accord conclu, la mise en place de l’HAD peut s’effectuer en quelques heures seulement.
Une chambre d’hôpital à la maison…
Une hospitalisation à domicile correspond au même statut qu’un établissement de santé. Ce n’est pas un « service », c’est l’hôpital qui se déplace dans les mêmes conditions de prise en charge qu’une hospitalisation classique.
Il se peut donc que le patient ait besoin d’un mobilier adapté qui lui permette ainsi qu’aux équipes soignantes d’assurer les soins dans des conditions optimales. Sur prescription, il peut être livré au domicile du malade :
- le matériel nécessaire aux soins,
- un lit médicalisé,
- un matelas spécial anti-escarres,
- une tablette pour manger,
- un fauteuil adapté,
- …
Ce type de matériel est inclus dans la prise en charge, de la même façon qu’à l’hôpital on ne vous fera pas payer le lit en supplément. Cependant tout cela ayant un coût, on ne fait pas non plus de dépenses inutiles, et si le patient n’a pas besoin d’un lit médicalisé, il ne lui en sera pas prescrit.
Les repas en revanche ne sont pas pris en charge dans le cadre de l’HAD, sauf si le médecin prescrit un régime particulier, auquel cas, des produits diététiques peuvent être livrés au malade (comme dans le cas d’un régime hyperprotéiné par exemple).
Notez que si le patient vit en institution, par exemple dans un EHPAD (établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes), et que celui-ci ne propose pas le niveau de soins nécessaires à l’état du patient, l’HAD peut être mise en place au sein de l’EHPAD.
L’équipe médicale de l’hospitalisation à domicile
On retrouve dans les équipes de l’HAD les mêmes professionnels qu’à l’hôpital, à savoir, des infirmiers, aides-soignants, puéricultrices, sages-femmes…
Les personnels soignants de l’HAD sont plus polyvalents qu’à l’hôpital où ils sont rattachés à un seul service. En HAD, ils sont amenés à soigner des pathologies plus diverses.
Bien entendu un médecin coordonnateur suit également le patient, comme cela serait le cas dans les murs d’un hôpital.
La prestation est assurée 24h/24, 7j/7, 365 jours par an. Les patients peuvent contacter les équipes soignantes à tout moment et, en cas d’urgence, des protocoles sont mis en place avec le SAMU.
Le rôle des proches du patient
Il n’y a pas d’hospitalisation à domicile possible sans la participation des proches du patient. On les appelle les « aidants ». Il peut s’agir de la famille, d’amis, de voisins proches, mais dans tous les cas, ces derniers doivent prendre la mesure de leur rôle car cela peut représenter une grosse charge de responsabilités et un investissement important en termes de temps.
Le fonctionnement de l’HAD prévoit que les aidants puissent contacter des psychologues s’ils ont besoin de soutien. Ils le font peu car bien souvent les aidants nient leurs propres besoins au profit de ceux du malade.
Malades et aidants ont le droit de poser toutes les questions qui les inquiètent avant d’envisager une HAD, car le confort que représente le fait d’être hospitalisé chez soi, dans son propre univers, non contraint aux horaires de visite se révèle parfois un avantage assez restreint par rapport au stress que peut engendrer le fait de ne pas disposer de proximité des équipes soignantes présentes 24h/24… Cela ne convient pas à tout le monde, même si c’est médicalement possible.
Si l’état du patient se dégrade au cours de l’HAD, ou si la situation liée par exemple aux aidants ne permet plus de garantir de bonnes conditions pour que le malade reste à domicile, un retour dans les murs de l’hôpital est envisagé.
La sortie de l’HAD
Autant l’entrée en HAD est souvent assez simple et peut se faire très rapidement, autant la sortie d’une HAD est parfois source d’angoisses.
En effet, pour le patient et les aidants, le fait d’être d’un seul coup livrés à eux-mêmes, ou d’être pris en charge ensuite par des services différents, comme un SSIAD (service de Soins infirmiers à domicile), peut s’avérer déroutant. Ils peuvent craindre d’être moins bien suivis, d’avoir à supporter de nouvelles démarches administratives ou d’être moins bien remboursés.
Là encore, il ne faut pas hésiter à poser des questions, notamment aux assistantes sociales de l’HAD.
Le coût de l’HAD
Certes l’HAD est tout à fait adaptée et pertinente dans de nombreux cas (une enquête réalisée dans le cadre de l’HAD de l’Assistance publique des Hôpitaux de Paris a révélé que 98% des patients étaient satisfaits), mais elle est en particulier génératrice d’économies pour l’Assurance maladie. Une HAD coûte 3 à 4 fois moins chère qu’une hospitalisation classique du fait que les coûts structurels sont bien moindres, que les repas ne sont pas prévus, le linge non plus…
Tout porte donc à croire que l’HAD a un bel avenir et sera amenée à se développer de plus en plus.
Côté usager, le remboursement d’une HAD se fait dans les mêmes conditions qu’une hospitalisation classique, c’est-à-dire une prise en charge à 80% par la sécurité sociale (les 20% restant étant en général pris en charge par la complémentaire santé lorsqu’on en dispose) ou à 100% dans le cas d’une ALD (affection de longue durée).
Un grand merci pour son aide à Nicolas Brun, coordonnateur à l’Union nationale des Associations familiales (UNAF).
En savoir plus :
- 66 Millions d’Impatients – Soins à domicile : Médecins, dentistes et kinés
- 66 Millions d’Impatients – Soins infirmiers à domicile et opticiens mobiles
- Service public.fr – Hospitalisation à domicile
- Assistance publique-Hôpitaux de Paris – Hospitalisation à domicile


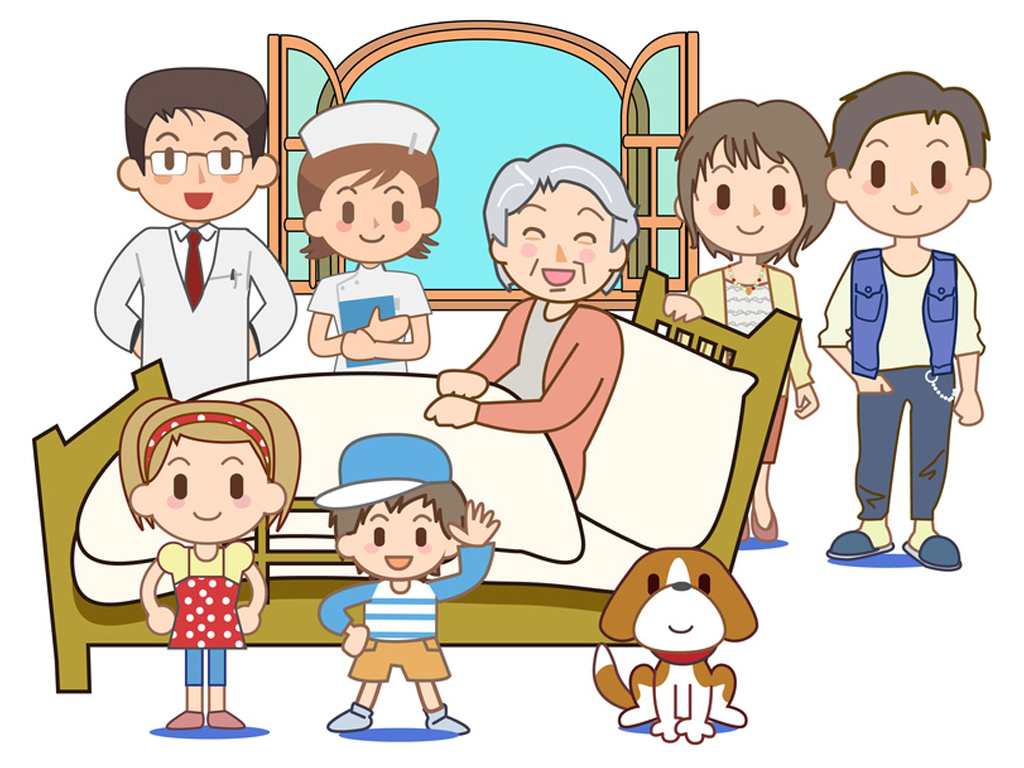

Bjr, Une double HAD qui s'est mal déroulée d'un point de vue administratif, avec des soucis pour une personne non hospitalisée, mais vivant au domicile, car il y avait deux personnes âgées dans la salle à manger de 22 m carrés. Que faire ? Qu'espérer au regard de pareils soucis.
Bjr Que penser d’une double HAD de deux personnes agées, sans surveillance nocturne ?
Cdt
Il n’y a pas d’hospitalisation à domicile possible sans la participation des proches du patient. On les appelle les « aidants ». Il peut s’agir de la famille, d’amis, de voisins proches, mais dans tous les cas, ces derniers doivent prendre la mesure de leur rôle car cela peut représenter une grosse charge de responsabilités et un investissement important en termes de temps. Le fonctionnement de l’HAD prévoit que les aidants puissent contacter des psychologues s’ils ont besoin de soutien. Ils le font peu car bien souvent les aidants nient leurs propres besoins au profit de ceux du malade. Malades et aidants ont le droit de poser toutes les questions qui les inquiètent avant d’envisager une HAD, car le confort que représente le fait d’être hospitalisé chez soi, dans son propre univers, non contraint aux horaires de visite se révèle parfois un avantage assez restreint par rapport au stress que peut engendrer le fait de ne pas disposer de proximité des équipes soignantes présentes 24h/24… Cela ne convient pas à tout le monde, même si c’est médicalement possible. Si l’état du patient se dégrade au cours de l’HAD, ou si la situation liée par exemple aux aidants ne permet plus de garantir de bonnes conditions pour que le malade reste à domicile, un retour dans les murs de l’hôpital est envisagé. =>>>>>> Je me pose des questions sur cet aspect, car il n'y a pas de proches, sauf une personne elle-même malade au domicile. Que faire ?