En cette 20e Semaine nationale du rein qui se tient jusqu’au 15 mars, des stands d’information et des lieux de dépistage gratuit vous attendent partout en France. Pour cette édition 2025, l’accent est mis sur la nécessité d’une détection précoce. Un chiffre : 6 millions de Français ont les reins malades et l’ignorent. Or, un dépistage tardif peut entraîner des conséquences graves, voire irréversibles. Associations et spécialistes sont unanimes : une meilleure prévention s’impose.
Une personne sur dix en France est concernée par la maladie rénale, sous une forme plus ou moins avancée, ce qui représente plus que le nombre total de cancers diagnostiqués chaque année ; 100 000 patients sont dialysés ou greffés. L’association France Rein, dont les principales missions sont d’informer, soutenir et défendre les patients insuffisants rénaux, est à l’origine de cette semaine nationale du rein. « Avec une prévention plus structurée, il y aurait 20 % de personnes en moins en dialyse », estime son président Jan-Marc Charrel. Pour Renaloo, autre association de patients, qui vient de lancer une grande campagne nationale de sensibilisation avec l’Assurance maladie intitulée « Ne pas faire contrôler ses reins, c’est comme ne pas faire contrôler ses freins », la prévention est également une urgence médicale, mais économique aussi. « La maladie rénale altère profondément la qualité de vie des malades et est extrêmement coûteuse pour l’Assurance maladie, en particulier quand elle devient chronique. Le coût moyen annuel d’un patient dialysé s’élève à 63 000 euros. La facture totale de la prise en charge pour les seuls patients en traitement de suppléance (dialyse ou greffe) grimpe à 4,4 milliards par an », rapporte sa fondatrice, Yvanie Caillé.
Un manque de sensibilisation
En cause, le manque de sensibilisation et de prévention. Les raisons de cette carence sont nombreuses. La maladie rénale est silencieuse, souvent asymptomatique, y compris jusqu’à un stade avancé. Par ailleurs, le rein, organe pourtant vital, est mal connu du grand public, ainsi que de nombreux médecins généralistes. S’il fait partie de l’appareil urinaire, ses multiples fonctions, toutes importantes, sont souvent moins immédiatement évidentes. « En plus de l’élimination de l’eau et des déchets, les reins assurent de multiples contrôles, dont ceux de l’élimination du sel et de l’hypertension artérielle, de la production d’EPO (érythropoïétine) et de l’absence d’anémie, de la production de la vitamine D active, de l’élimination du calcium et du phosphate et de la solidité du squelette… », détaille le Pr François Vrtovsnik, chef de Service de Néphrologie à l’Hôpital Bichat à Paris, président de la Société Francophone de Néphrologie Dialyse et Transplantation (SFNDT). D’après Renaloo, 3 Français sur 4 se déclarent non ou mal informés sur la maladie rénale chronique. A l’occasion de cette semaine du rein 2025, une fiche d’information a donc été éditée, à l’attention des médecins généralistes. Un document auquel France Rein a contribué pour porter la voix des patients. « Les généralistes sont souvent dépourvus face à cette maladie complexe. Nous pouvons les aider à mieux accompagner leurs patients, à savoir quand il faut demander l’avis d’un néphrologue et comment lui passer la main », explique Jan-Marc Charrel, lui-même insuffisant rénal chronique.
Une généralisation du dépistage pour les profils à risque
Les profils à risque de développer une maladie rénale chronique sont pourtant clairement identifiés : il s’agit de personnes souffrant d’hypertension artérielle, de diabète ou d’obésité. Le vieillissement est également un facteur aggravant. Mais certaines maladies rénales rares, auto-immunes ou génétiques, touchent majoritairement des personnes jeunes et sans facteurs de risque. Elles représentent environ un quart des causes de dialyse. Certains signes doivent aussi alerter : fatigue persistante, troubles digestifs, œdèmes, etc. Associations de patients et spécialistes, tous demandent une généralisation d’un dépistage pour ces profils à risque, recommandé annuellement, mais trop peu réalisé, rappelle Renaloo qui a contribué au rapport Charges et produits pour 2025 de l’Assurance maladie. Pourtant, il repose sur deux tests simples et peu coûteux : une prise de sang (taux de créatinine) et un examen des urines.
Pour le Pr François Vrtovsnik, « un dépistage précoce permet notamment de ralentir l’évolution de la maladie, d’éviter la dialyse et de préserver la qualité de vie. Quand l’insuffisance rénale est aiguë, un traitement adapté permet souvent la guérison. Quand elle est chronique, c’est-à-dire qu’elle dure depuis plus de trois mois, c’est beaucoup moins le cas ». Les dégâts occasionnés sont souvent irréversibles. Des traitements de suppléance sont nécessaires, avec un impact sévère sur le quotidien et l’espérance de vie des patients. « La maladie rénale chronique est aussi un facteur de risque majeur d’accidents cardiovasculaires et d’autres complications graves », complète Yvanie Caillé.
Des traitements récents efficaces pour ralentir la maladie
Une bonne nouvelle, cependant. « Des traitements récents ont démontré leur efficacité pour ralentir la progression de la maladie rénale chronique et réduire le risque d’insuffisance rénale terminale », se réjouit la fondatrice de Renaloo, tout en regrettant « leur insuffisante utilisation faute, on y revient toujours, d’un manque d’information des médecins généralistes ». Pour le Pr Vrtovsnik, un autre signe est encourageant. Selon les données du dernier rapport de l’Agence de la biomédecine registre rein, le nombre de nouveaux patients qui commencent un traitement de suppléance a diminué en 2022. Et les premiers chiffres pour 2023, qui restent à consolider, semblent vouloir confirmer cette tendance : « C’est une nouvelle majeure ! Elle pourrait être le résultat d’une meilleure prise en charge médicamenteuse et d’un meilleur accompagnement de la maladie par les professionnels de santé (infirmières, IPA, diététiciennes, psychologues..), mis en place depuis 2020 pour les formes les plus sévères. C’est pour l’instant un peu spéculatif, mais ça semble aller dans le bon sens », se félicite le spécialiste.
Enfin, en matière de prévention, les associations plaident à l’unisson en faveur d’une implication des patients. « Il faut qu’ils deviennent acteurs de leur santé. Qu’ils s’intéressent à leur maladie pour pouvoir mieux la traiter, tout en discutant avec les soignants. Qu’ils se tournent aussi vers nous pour avoir un retour d’expérience, trouver une parole réconfortante, pour confronter la parole médicale », souligne Jan-Marc Charrel de France Rein. Pour Renaloo, qui appelle à la « révolution du rein », il est indispensable de mettre en place une stratégie nationale de santé rénale, impliquant également les patients. Ses 10 propositions pour refonder la prise en charge de la maladie rénale chronique ont justement cet objectif.
« Personne ne m’a conseillé un suivi régulier »
« J’ai 77 ans. Je suis malade rénal depuis ma plus tendre enfance, ce qui m’a valu d’être élevé dans du coton, privé de tout ce que font les enfants : de la bicyclette, du foot… C’était très difficile à vivre. À l'adolescence, alors que les symptômes de ma maladie s’étaient estompés, j’ai pu prendre un peu plus mes aises, bousculer mes parents, afin de pouvoir sortir un peu de ce cocon. J’ai ensuite fait des études, je suis devenu architecte, je me suis marié, j’ai eu des enfants. J’ai bien eu quelques problèmes d’hypertension, mais personne ne m’a dit de faire attention à mes reins. A l’époque, on n’en parlait pas. Vers la trentaine, toutefois, un collègue qui était sous dialyse, et à qui j’avais parlé de ma maladie quand j’étais enfant, m’a alerté. J’ai alors fait un bilan. L’examen a montré que j’avais bien eu quelque chose étant petit, mais qu’à ce stade, on ne voyait plus rien. Pas de quoi s’inquiéter, donc. Et personne ne m’a conseillé un suivi plus régulier. Bref, j’ai continué à vivre normalement. Vers la cinquantaine, alors que des symptômes étaient apparus, démangeaisons, œdèmes, etc., je suis allé voir mon médecin généraliste. Nouveau bilan…qui a révélé un taux de créatinine et un débit de filtration glomérulaire élevés. Il m’a orienté vers une consultation spécialisée. On m’a dit que je souffrais d’insuffisance rénale chronique, qu’il fallait me préparer à envisager une dialyse ou une greffe. Cette annonce de la part du néphrologue de garde à l'hôpital, sans pincettes, a été brutale. Heureusement, une jeune néphrologue qui venait d’arriver dans le service m’a pris en charge. Elle m’a rassuré, moi et ma famille, dit qu’on avait du temps, m’a tout expliqué, les différents traitements de suppléance. J’ai pu réfléchir à la manière dont j’allais devoir vivre avec cette maladie. Par souci pratique, étant profession libérale, j’ai fait le choix d’une dialyse péritonéale à domicile de nuit. Elle a duré huit mois, avec un impact plus limité qu’une autre formule. En parallèle, j’avais la chance que ma femme et mes deux filles se soient proposées pour me donner un rein. Mon épouse a été choisie, la compatibilité des tissus étant meilleure. Le temps de la greffe est arrivé. Elle a parfaitement fonctionné. Deux semaines après, je reprenais une vie pour ainsi dire normale, avec malgré tout beaucoup de médicaments à prendre et de nombreuses analyses à effectuer. Aujourd’hui, elles sont plus espacées. Rétrospectivement, je n’ai pas de regret de ne pas avoir fait un dépistage plus précoce, car à l’époque, la prévention et les connaissances sur la maladie n’étaient pas aussi élaborées qu’aujourd’hui. Au regard de mon histoire, je conseille à tout le monde de profiter du dispositif Mon Bilan Prévention, et aux personnes avec un profil à risque d’être particulièrement vigilantes. »


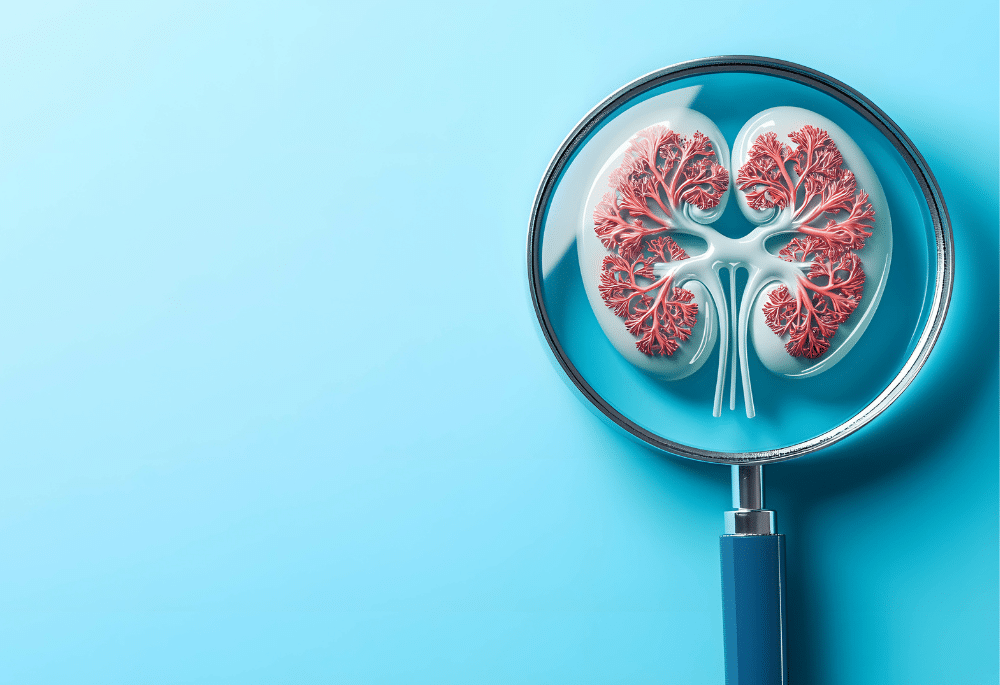

Laisser un commentaire public