Alors que sur le plan médical les nanoparticules semblent offrir de nouvelles voies de guérison et de diagnostic, on nous invite dans le même temps à nous méfier peut-être des crèmes solaires qui en contiennent. Alors, dangereuses ou salvatrices, utiles ou superflues, maîtrisées ou incontrôlables ? Les nanoparticules présentent-elles un danger pour notre santé ? Y sommes-nous d’ailleurs exposés de façon inquiétante ?
Dans son livre paru le 1er avril 2016 et intitulé Faut-il avoir peur des nanos ?, Francelyne Marano, professeure émérite de biologie cellulaire et de toxicologie à l’université Paris-Diderot nous aide à comprendre pourquoi les applications liées aux nanotechnologies sont si intéressantes et fait le point sur les connaissances actuelles en matière d’impact des nanoparticules sur notre santé.
Que sont les nanoparticules, les nanotechnologies et les nanomatériaux
La définition européenne définit la nanoparticule comme un élément dont la dimension se situe entre 1 et 100 nm (nanomètres) en sachant qu’1 nm est 1 milliard de fois plus petit qu’un mètre.
Les techniques permettant de manipuler les éléments d’une telle dimension sont appelées nanotechnologies, qui elles-mêmes produisent des nanomatériaux.
Il y a en fait 2 sortes de nanoparticules :
- Celles que l’on appelle plus communément les « particules ultrafines » et qui regroupent les nanoparticules naturelles (comme celles émises lors des éruptions volcaniques) et les nanoparticules qui se forment spontanément dans l’atmosphère (comme celles, malheureusement bien connues, résultant de la transformation chimique des polluants rejetés par le trafic routier par exemple).
- Et les nanoparticules manufacturées, c’est-à-dire produites à dessein grâce aux nanotechnologies pour diverses applications.
Pourquoi les nanotechnologies suscitent-elles autant d’intérêt ?
Comment ces minuscules éléments peuvent-ils être si puissants au point de devenir incontournables ? L’auteure a choisi l’explication très didactique que Louis Laurent, directeur recherche et veille à l’ANSES* fournit en 2014 dans l’ouvrage Nanosciences et nanotechnologies, évolution ou révolution et qui expose : « Prenons un cube de 1 cm de côté, il a une surface de 6cm2. Si on coupe ce cube en 1000 petits cubes, ils ont collectivement une surface de 60cm2. Si on continue jusqu’à découper la matière en cubes de 10nm, on termine avec un milliard de milliards de cubes dont la surface représente 600m2. La caractéristique fondamentale d’un matériau réduit à l’état de poudre ultra-divisée est donc sa gigantesque surface lorsqu’on la rapporte à son volume et à son poids ». Voilà comment le travail sur l’infiniment petit de la matière peut amplifier ses propriétés, voire les transformer. C’est une sorte de super pouvoir qui semble apporter de réels bénéfices, notamment sur le plan de la recherche médicale, mais qui n’a pas échappé non plus aux industriels et à leur soif de rentabilité…
Où trouve-t-on des nanoparticules ?
En réalité, comme le précise l’auteure, les nanoparticules ont envahi notre quotidien, et malheureusement souvent à notre insu. En effet, aucun étiquetage n’est prévu pour nous avertir de la présence de nanoparticules dans les produits mis sur le marché et bien que depuis 2005 l’inventaire du PEN (Project on Emerging Nanotechnologies) recense les produits commercialisés contenant des nanomatériaux, les industriels n’ont pas l’obligation de les déclarer. Cet inventaire est donc très loin d’être exhaustif mais il donne tout de même une tendance sur leur nombre croissant (on est passé de 54 produits recensés en 2005 à 1628 en 2013) et sur les catégories où l’on retrouve le plus de nanomatériaux.
Ainsi arrivent largement en tête les produits concernant la santé et le fitness, dont les cosmétiques, les crèmes et les dentifrices… des produits en contact direct avec les consommateurs. Viennent ensuite des produits destinés à la maison et au jardin (les nanoparticules ont rendu certains types de verres autonettoyants, par exemple), des produits destinés à l’industrie automobile (les nanoparticules rendent les matériaux plus légers et plus résistants), suivis des produits que l’on retrouve dans l’alimentation et les boissons (plus précisément dans certains additifs alimentaires), puis dans l’électronique et l’informatique (les nanoparticules permettent de travailler sur la miniaturisation). On trouve même quelques produits destinés aux enfants, comme des jouets et des bonbons (heureusement, il s’agit de la catégorie la plus faiblement représentée !).
L’auteure dresse l’état du marché et les priorités des principales nanoparticules exploitées (comme le nanotitane utilisé dans les crèmes solaires pour son grand pouvoir de filtration des UV), ce qui nous permet en tant que consommateur de faire un peu le tri, mais elle déplore surtout, comme de nombreuses associations, notamment environnementales, le peu d’études et de précautions prises autour des nanos.
L’impact des nanoparticules sur notre santé et la nanotoxicologie
On s’inquiète peu de l’usage fait des nanoparticules sur l’électronique et l’informatique (elles permettent évidemment de tout miniaturiser), pourtant ces appareils sont tous destinés un jour ou l’autre à finir à la casse… Et que deviennent alors les nanoparticules manufacturées qui se répandent dans notre environnement ? Cela, personne ne le sait vraiment encore.
En revanche, quand on a compris à quel point ces particules sont petites, et qu’elles se retrouvent dans nos cosmétiques et notre alimentation, on peut se poser, à raison, la question de savoir si elles sont capables de traverser notre peau, voire les barrières pulmonaires, intestinales, placentaires ou celle du cerveau.
L’auteure consacre ainsi tout un chapitre sur les connaissances actuelles concernant chacune de ces barrières biologiques. Si l’on prend l’exemple des crèmes pour le corps, qui représentent une catégorie où l’on utilise de plus en plus de nanoparticules, l’ANSM (Agence Nationale de sécurité du Médicament et des produits de santé) a conclu que les nanoparticules pouvaient franchir l’épiderme (la couche supérieure de la peau) mais pas le derme (la couche profonde), à condition que la peau ne soit pas lésée !
Côté alimentation, les nanoparticules peuvent se retrouver sous forme d’additifs notamment dans le E171 et le E551/552. Dans les deux cas, la forme micro et la forme nanométrique du dioxyde de titane contenu dans le premier et de l’oxyde de silice dans le second ne sont pas différenciées. Le consommateur ne sait donc pas qu’il est éventuellement en train d’avaler des nanoparticules.
En fait, c’est un peu ce modèle qui s’est appliqué dans l’utilisation générale des nanoparticules, à savoir que les industriels ont profité du fait que l’on n’a pas remis en cause la mise sur le marché de la version nanométrique des produits chimiques déjà autorisés. Mais si la multiplicité des surfaces des nanoparticules amplifie leurs bénéfices, elle augmente aussi très probablement leur toxicité, et peut-être interagissent-elles différemment avec nos cellules du fait de leur taille ?
On sait que dans le cas d’une peau lésée, les nanoparticules peuvent franchir la barrière cutanée. De même, comme l’explique l’auteure, on a retrouvé des nanoparticules dans les organes internes de rongeurs à qui l’on a donné des aliments qui en contenaient. Le principe de précaution ne devrait-il pas prévaloir afin de ne pas nous retrouver pris au piège d’un scandale sanitaire comme celui de l’amiante ?
La nanomédecine
Les bénéfices des nanoparticules sont incontestables d’un point de vue théorique, mais la balance bénéfice-risque de leur utilisation appliquée à de nombreux domaines dans la vie réelle est loin d’être suffisamment bien évaluée et les industriels se gardent bien d’accompagner les recherches concernant la nanotoxicologie.
Cette balance fait également sens dans l’application des nanoparticules à des fins thérapeutiques puisqu’elles servent désormais, notamment dans le traitement du cancer, à « encapsuler » les molécules de chimiothérapie pour les mener directement jusqu’à la tumeur. Dans de tels cas, un réel bénéfice apparaît puisque les nanoparticules permettent aux chimiothérapies, par définition très agressives, de ne s’en prendre qu’aux cellules cancéreuses et de réduire les effets secondaires (nausées, fatigue, chute de cheveux…). Mais nous en sommes encore aux prémisses de cette technique et il faudra suivre de près ce que deviennent ces nanoparticules dans l’organisme une fois leur mission effectuée…
En plus de l’aspect thérapeutique, la partie diagnostic peut également bénéficier des pouvoirs des nanoparticules. Elles ont notamment permis de mettre au point de nouveaux produits de contraste très efficaces pour les IRM.
Et, toujours sur le plan médical et humain, il va aussi falloir être vigilant par rapport au fait que, les nanoparticules ayant le pouvoir d’amplifier les choses, certains y voient déjà la possibilité d’augmenter nos capacités biologiques ou intellectuelles… L’éthique doit donc être, pour toutes ces raisons, au cœur du débat sur les nanos !
Faut-il avoir peur des nanos ? – Par Francelyne Marano, Editions Buchet-Chastel, 128 pages – 12€
En savoir plus :
Rapport de l’Affsaps : Etat des connaissances relatif aux nanoparticules de dioxyde de titane et d’oxyde de zinc dans les produits cosmétiques en termes de pénétration cutanée, de génotoxicité et de cancérogenèse
* Site de l’ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail)


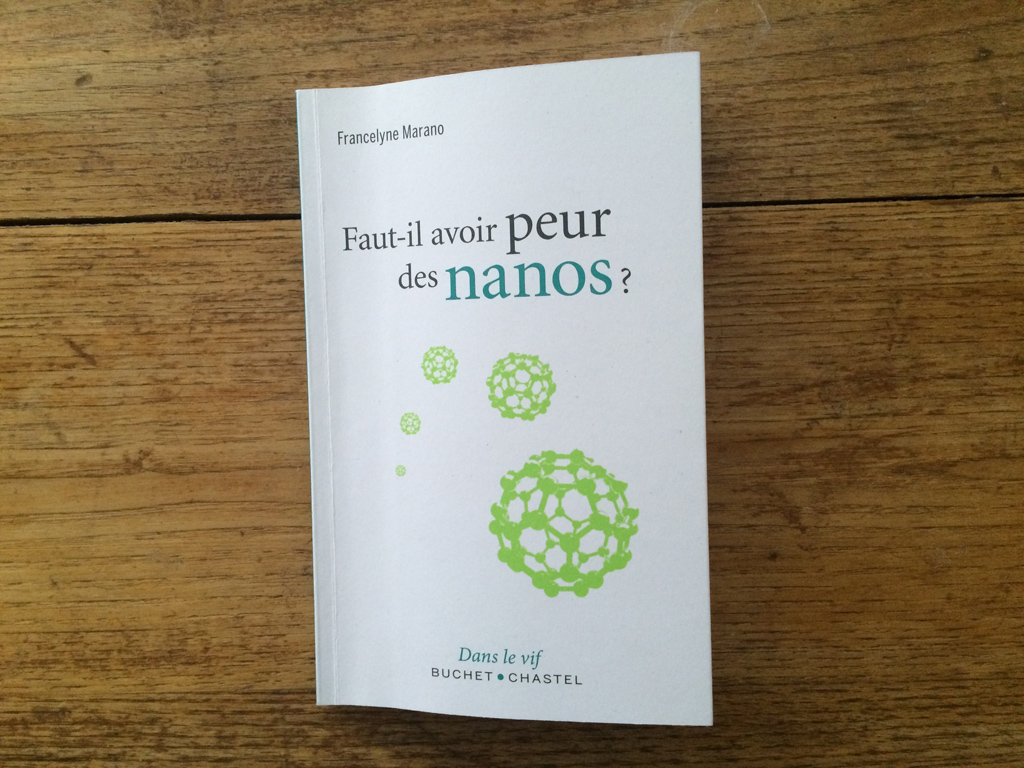

Laisser un commentaire public