Le ministère de la Santé a présenté mardi matin un nouveau spot TV visant à promouvoir le recours aux médicaments génériques. Cette mesure permettrait d’économiser quelque 340 millions d’euros, espèrent les pouvoirs publics.
« En prenant son médicament générique, Jean peut compter sur des dizaines d’experts, des centaines de tests réussis, des milliers de professionnels de santé mobilisés et chaque jour des millions de personnes soignées… comme lui ! Pour devenir un médicament générique, il faut 20 ans d’études et de pratique. Devenir génériques, ça se mérite. »
Tel est le message d’une campagne d’information diffusée sur les chaînes nationales du 27 septembre au 18 octobre visant à « changer le regard des Français sur le médicament générique », et présentée ce matin par la ministre de la santé, Marisol Touraine :
Cette présentation fait suite à celle du Projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2017 (PLFSS 2017) le 23 septembre dernier, qui prévoit, entre autres mesures, d’économiser 340 millions d’euros grâce à la promotion et au développement des médicaments génériques.
Un potentiel d’économies encore exploitable
Un souhait déjà exprimé en mars 2015 par les pouvoirs publics lors du lancement d’un plan national de promotion du générique visant un montant d’économies (quasi) identique. Le générique est une copie d’un médicament qui contient la même quantité de principe(s) actif(s) que l’original (qu’on appelle le «princeps»). Ces copies peuvent être commercialisées dès que le brevet protégeant le princeps arrive à échéance (en général de 10 à 15 ans après sa mise sur le marché).
Les fabricants de génériques n’ayant pas à supporter les coûts de recherche et de développement du médicament, ils sont en mesure de proposer des prix bien inférieurs à ceux des princeps. C’est en tout cas ce qui leur est demandé. Pour établir le prix du générique, les pouvoirs publics s’appuient en général sur celui du médicament d’origine et lui applique une décote de 60 %. Depuis que ces derniers ont décidé d’en promouvoir l’usage à la fin des années 90, les génériques ont permis à la collectivité d’engranger des économies pour un montant total d’environ 18 milliards d’euros.
En France, sur l’ensemble des médicaments qui peuvent être remplacés par un générique (tous ne le sont pas forcément), le taux de substitution a explosé sur les quinze dernières années, passant de 28 % en 2000 à plus de 80 % fin 2014. Le potentiel d’économies reste important à en croire les efforts que le ministère de la Santé entend consentir pour promouvoir l’usage de ces médicaments.
Les génériques, pas assez automatiques
L’objectif de la campagne lancée ce matin par la ministre : « renforcer la confiance et les connaissances des Français, patients comme professionnels de santé, en mettant à leur disposition une information claire et précise ». De fait, la défiance vis-à-vis de ces médicaments reste ancrée parmi certains patients et professionnels de santé, ces derniers continuant de prescrire le princeps quand bien même un générique pourrait l’être à sa place.
Dans un rapport publié en 2012, l’Inspection générale des Affaires sociales (Igas) pointait « une réticence accrue des patients vis-à-vis des génériques » ou encore l’utilisation abusive de la mention « non substituable (NS) » par les médecins (qui interdit aux pharmaciens de substituer le médicament prescrit) pour expliquer un relatif essoufflement du recours aux génériques. Pour l’Assurance Maladie le coût moyen de l’usage abusif de la mention « non substituable » s’élèverait à quelque 110 millions d’euros par an.
Le générique n’est pas toujours recommandé
En 2014 et 2015, l’Assurance Maladie a mené une action de contrôle auprès de 500 praticiens utilisant de façon quasi systématique et répétée la mention « NS » (taux supérieur à 30 %) sans justification médicale. En cas d’abus avéré, le médecin est dans un premier temps averti. Si ces pratiques perdurent, il est susceptible d’encourir une pénalité financière équivalente au montant de l’économie qu’il n’a pas engendrée. Suite à cette action, près d’un tiers des praticiens avait significativement diminué le recours à la mention « NS ».
Précisons quand même que pour certaines pathologies dites "à marge thérapeutique étroite ", les troubles de la thyroïde ou l’épilepsie notamment, « tout changement de spécialité, rappelle l’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM), qu’il s’opère d’une spécialité de référence vers une spécialité générique, d’une spécialité générique vers une spécialité de référence ou d’une spécialité générique vers une autre spécialité générique, doit s’envisager avec précaution ».
Chez les patients âgés, enfin, ou lorsqu’il existe un risque de confusion ou d’erreur médicamenteuse, le médecin est invité sur sa prescription à maintenir le médicament que le patient a l’habitude de se voir délivrer.


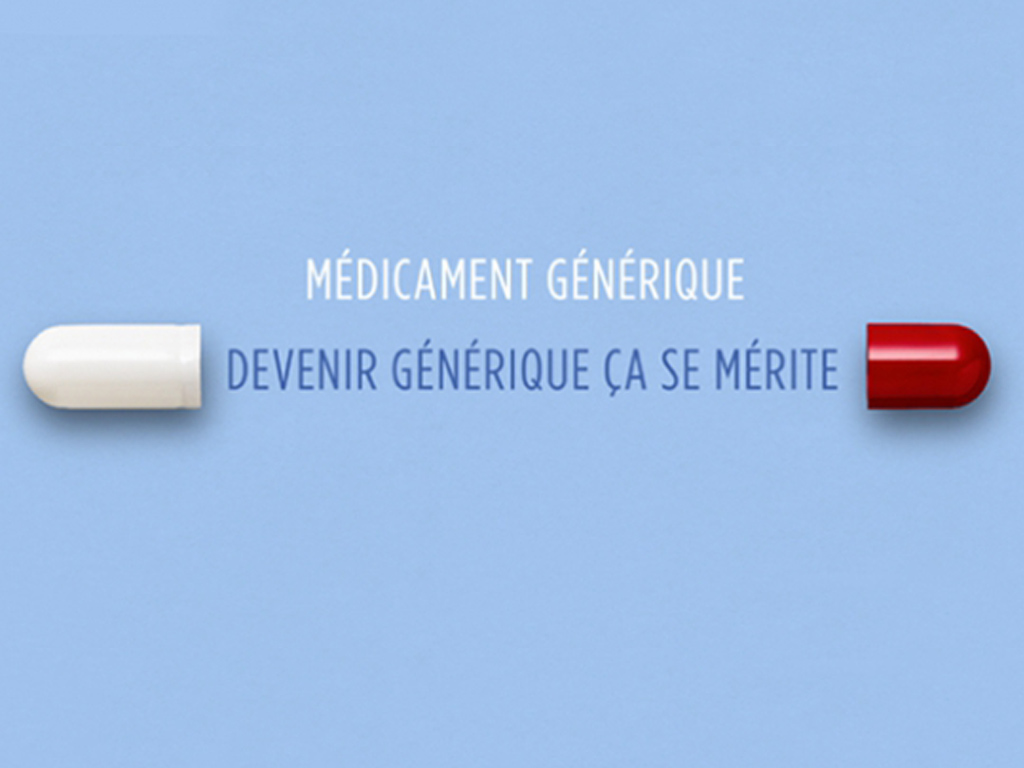

Laisser un commentaire public